  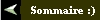

 |
UNE RELIGION DU SALUT : |
Le catharisme est une religion du salut
fondée sur la Révélation. Son Livre Saint est le Nouveau Testament. Sa prière
est le Pater. L'Envoyé de Dieu, auteur de la Révélation, est le Christ, et lui
seul. Le salut s'opère par l'ascèse et le baptême. Le catharisme est donc un
christianisme ; il ne s'est jamais prétendu autre chose, et s'est même affirmé
comme porteur de l'authentique message du Christ, à l'exclusion de toute
référence à quelque autre religion que ce soit.
Mais l'interprétation que les cathares
avaient des Ecritures était incompatible avec l'orthodoxie romaine. Ils ne
croyaient ni au baptême par l'eau, ni à l'eucharistie, pas plus qu'à aucun des
sacrements de l'Eglise catholique.
Leur christianisme est sans Passion
rédemptrice, sans Jugement dernier, sans Résurrection. Leur théologie, leur
liturgie, leur morale, reposaient sur des fondements dogmatiques en complète
opposition avec ceux du catholicisme. Leur dualisme, en particulier, apparut
comme une résurgence du Manichéisme (la religion fondée au troisième siècle par
le prophète persan Manès ou Mani). Si bien qu'au sein de la Chrétienté
occidentale, ce christianisme « autre » fut perçu comme un corps étranger
menaçant à la fois le dogme et les structures de l'Eglise officielle (laquelle,
du XI au XV° siècle, soumit le catharisme à une répression terrible, et finit
par en avoir raison).
 |
COMMENT CONNAIT-ON LE CATHARISME ? : |
Le catharisme est connu grâce à trois
catégories de sources historiques.
Tout d'abord, les textes cathares
eux-mêmes. Ils devaient être assez nombreux, mais la persécution les a, pour la
plupart, fait disparaître. Nous sont quand même parvenus deux traités
dogmatiques et deux rituels. L'un de ces traités, conservé à Florence, est un
manuscrit latin des environs de 1260, résumant un vaste ouvrage que le docteur
cathare Jean de Lugio, de Bergame, avait composé peu après 1230 : le Livre des
deux Principes. L'autre, découvert à Prague en 1939, est la copie, toujours en
latin, d'un traité anonyme composé en Languedoc au début du XIII° siècle, et
dont l'auteur fut peut-être le Parfait Barthélémy de Carcassonne. Si ces
documents sont extrêmement précieux pour la connaissance de la théologie
dualiste, les deux rituels ne le sont pas moins en ce qui concerne la liturgie :
aussi bien le Rituel latin de Florence, que le Rituel occitan conservé à Lyon
avec la totalité du Nouveau Testament traduit en occitan à l'usage des cathares
languedociens. Tous documents qui datent des environs de 1250. Il faut leur
ajouter quelques Apocryphes, c'est-à-dire des textes d'inspiration chrétienne
utilisés par les cathares, mais qui, non orthodoxes, n'ont pas été retenus comme
Ecrits canoniques.
Tout aussi utiles, les ouvrages de
controverse par lesquels les théologiens catholiques analysaient et tentaient de
réfuter le catharisme. On en connaît plus de trente, écrits à la fin du XII°
siècle et tout au long du XIII°, au demeurant d'importance et de valeur
inégales. Il serait puéril de croire qu'ils déformaient à plaisir la religion
qu'ils combattaient ; leurs auteurs mettent eux-mêmes leurs lecteurs en garde
contre les calomnies faciles et les accusations ridicules dirigées parfois
contre les cathares. Seuls les intéressent les points sérieux de doctrine,
qu'ils discutent avec âpreté, mais avec, dans l'ensemble, une grande honnêteté
intellectuelle ; c'est en particulier le cas du Liber contra Manicheos de
l'ancien vaudois converti Durand de Huesca, de la Summa quadrapartita, écrite à
Montpellier par Alain de Lille, ou de la Summa adversus catharos de Moneta de
Crémone, pour ne citer que les plus importants, sans oublier bien sûr la Summa
de l'Italien Rainier Sacconi, qui se fit dominicain et inquisiteur après avoir
été dix-sept ans Parfait cathare, et qui savait mieux que tout autre ce qu'était
le catharisme.
Le dernier groupe de documents, ce sont
les sources judiciaires, c'est à dire les interrogatoires conduits par
l'Inquisition pendant près d'un siècle à partir de 1234. Particulièrement
abondantes pour le Languedoc (près de 7 000 dépositions conservées, qui nous
font connaître plus de mille Parfaits et quelque 40 000 croyants cathares), ces
sources sont encore en grande partie inédites (sauf les registres des
inquisiteurs Jacques Fournier et Geoffroy d'Ablis). Elles contiennent une
prodigieuse quantité d'informations sur la société du temps, et nous restituent
le catharisme vécu. Quand il y est question de doctrine, des croyances comme des
rites, ce qu'elles révèlent se recoupe bien avec ce que nous apprennent les
autres sources. De toute façon, il suffit d'être un peu familiarisé avec ces
documents, pour déceler sans trop de peine les faux fuyants, les ruses, voire
les mensonges des gens interrogés. C'est l'une de ces dépositions qui nous livre
le texte du célèbre Pater des cathares occitans : « Payre sant, Dieu dreyturier
de bons speritz ... » (Père saint, Dieu légitime des bons esprits ...).
 |
LE MYSTERE DES ORIGINES :
|
Depuis une quarantaine d'années, au
travers notamment des travaux d'Arno Borst, de Jean Duvernoy et de René Nelli,
la recherche historique, utilisant des sources inconnues ou insuffisamment
exploitées auparavant, a considérablement affiné la connaissance qu'on avait
jadis du catharisme, et l'a même assez profondément modifiée. Sans qu'on ait
pour autant résolu la mystérieuse question de ses origines, on ne voit plus
aujourd'hui le catharisme comme l'héritier direct du manichéisme persan, par
l'intermédiaire de diverses sectes « hérétiques » telles que les Pauliciens ou
les Messaliens. Que le catharisme rejoigne sur des points précis la religion de
Manès ne veut pas dire qu'il en découle. L'univers conceptuel des textes
cathares est totalement étranger, dans son vocabulaire, dans ses images, dans
ses mythes, à celui des écrits manichéens. Au demeurant, un certain nombre de
croyances fondamentales du catharisme sont antérieures à Manès, qui les a
certainement puisées lui-même chez les sectes gnostiques au sein desquelles il
fit son éducation : l'idée qu'il y a deux Principes créateurs opposés, que l'âme
est incréée et que, parcelle de substance divine, elle est exilée dans un monde
mauvais, prisonnière de la Matière et du Temps qui lui ont fait oublier sa
véritable essence ; l'idée que le salut doit nécessairement passer par une
initiation, par l'infusion d'une connaissance illuminatrice ; tout cela, qui est
à la fois manichéen et cathare, fut d'abord gnostique. Si bien que, plutôt que
de tenter de retrouver de très hypothétiques filiations, la recherche s'oriente
aujourd'hui vers certains courants du christianisme primitif qui, sans pouvoir
pour autant être totalement assimilés au gnosticisme, ont pu subir l'influence
de la Gnose et infléchir dans un sens très particulier la lecture et
l'interprétation du Nouveau Testament. De même certains Pères de l'Eglise, tout
particulièrement l'Alexandrin Origène (II° siècle) ne sont sans doute pas
étrangers à l'élaboration du système religieux des cathares.
A noter enfin que la recherche
contemporaine tient pratiquement pour acquis que le bogomilisme bulgare du XII°
siècle et le catharisme que l'Occident connut du XII° au XIV° siècles,
constituent en fait une religion unique. C'est d'ailleurs un « pope » bogomile
de Constantinople, Nicétas, qui vint présider en 1167 le concile cathare de
Saint-Félix-de-Caraman près de Toulouse.
 |
DES « CATHARES » AUX « ALBIGEOIS » :
 |
L'EGLISE DES AMIS DE DIEU :
|
On a longtemps admis que le nom de «
cathare » venait du grec katharos, qui signifie « pur ». La chose n'est plus
tellement évidente aujourd'hui, dès lors qu'on remarque que les cathares ne se
sont jamais appelés eux-mêmes ainsi. Le terme ne fut utilisé que par leurs
adversaires, et il a de toute évidence une connotation infamante chez celui qui
l'employa pour la première fois dans ses sermons, en 1163, le moine allemand
Eckbert de Schonau. Trente-cinq ans plus tard, le polémiste catholique Alain de
Lille écrit qu'on les appelle ainsi, du latin catus, « chat », parce que « à ce
qu'on raconte, ils baisent le derrière d'un chat sous la forme duquel leur
apparaît Lucifer ... ». Injure qui peut s'expliquer par le fait que les cathares,
on va le voir, imputaient au Principe du Mal la création du monde visible, et
que dans beaucoup de traditions médiévales, notamment en Allemagne, le chat
était l'animal symbolique du Diable. De là à colporter que les cathares
adoraient le Créateur Mauvais sous les espèces d'un chat (alors qu'en fait ils
le détestaient) il n'y avait qu'un pas, que leurs calomniateurs pouvaient
aisément franchir. Il est significatif d'ailleurs que le mot allemand médiéval Ketter, qui veut dire « hérétique », dérive de Katte, « chat » (en allemand
moderne Ketzer et Katze). On affubla les dualistes de nombreux autres noms :
pendant qu'en Allemagne on les traitait de « cathares », on les appelait « poplicains » et « piphles » en Flandre, « patarins » en Italie et en Bosnie, «
bougres » ou « boulgres », c'est à dire « bulgares », dans la France du Nord (terme particulièrement infamant qui finit par devenir synonyme de sodomite). Sans
méchanceté cette fois, on les nomma souvent aussi « tisserands », « tisseyres »
en pays d'Oc (en raison du métier qu'ils exerçaient par prédilection). On
employa encore des termes géographiques : « les hérétiques agenais, toulousains,
albigeois ... » . C'est ce dernier vocable, qui, avec celui de « cathares »,
connut la plus grande fortune, au point de devenir l'équivalent de « cathares »,
même très loin de la région d'Albi.
Les cathares s'appelaient eux-mêmes «
chrétiens », « bons chrétiens ». Les croyants appelaient volontiers les Parfaits
« bons hommes », mais surtout « amis de Dieu », formule très fréquemment
attestée en Languedoc au XIII° siècle, et qui est la traduction littérale du
slavon « bogo-mil ». Si bien que, pour être absolument fidèle au vocabulaire du
temps, on devrait appeler l'Eglise dualiste, que l'on dit « bogomile » dans les
Balkans et « cathare » en Occident, « Eglise des Amis de Dieu ».
 |
LE « MONDE » ET LE « ROYAUME » :
|
S'il est un dualisme des deux Principes,
c'est parce que le catharisme est d'abord un dualisme des deux Créations. Tout
le système repose en effet sur ce qui est pour les cathares une irréfutable
donnée de l'expérience : l'existence de deux ordres de réalités opposées :
 |
d'une part, des réalités spirituelles,
invisibles et éternelles : c'est le Royaume du Dieu bon,
|
du « Dieu légitime », du « Dieu vivant et
vrai », du « Dieu de Justice et de Vérité », dont les âmes sont des émanations,
« comme les rayons émanent du soleil ». Ce Royaume, ce sont « la Terre nouvelle
et les Cieux nouveaux » dont parle Jean dans son Evangile et dans l'Apocalypse ;
« nouveaux », c'est-à-dire « autres », absolument différents, par essence, de la
terre et des cieux visibles.
 |
d'autre part, ce Monde visible, ensemble
de réalités matérielles et temporelles, donc transitoires,
|
vouées à la corruption et à la
destruction. C'est dans ce Monde que le Mal se manifeste : les corps de chair
connaissent la souffrance, la dégradation, la mort ; tous les vices, tous les
malheurs, tous les maux, sont liés à la condition matérielle. Jean l'a dit : le
Monde « est tout entier posé dans le Mal ».
On pourrait multiplier à l'infini les
citations du Nouveau Testament relevées par les cathares pour étayer cette
opposition fondamentale du Monde et du Royaume : « Ce que l'on voit est
transitoire, ce que l'on ne voit pas est éternel », « Le ciel et la terre
passeront, mes paroles ne passeront pas », « mon Royaume n'est pas de ce Monde
», « Je ne suis pas de ce Monde », etc.
Mais ces deux ordres de réalités ne sont
nullement égaux l'un en face de l'autre. Seul le Royaume est l'Etre absolu, car
il coïncide pour ainsi dire avec Dieu, dont la substance même, c'est l'Amour, la
Charité. Quant au Monde, puisqu'il est transitoire, il est vain ; c'est, à la
limite, comme s'il n'existait pas. Car à quoi bon exister, si ce n'est pour
toujours ? Ce monde n'est donc que Néant. Ce qui permet aux cathares de donner
une interprétation métaphysique, ontologique, de la phrase de Paul : « Sans la
charité, je ne suis rien », là où les catholiques ne voient plutôt qu'une simple
réflexion morale ; car les cathares la traduisent : « Sans la charité je suis
néant ». C'est-à-dire : si je n'ai pas en moi cette parcelle de substance divine
qu'est la charité, je suis réduit à un corps de chair corruptible et vain, qui
appartient seulement au Monde, et qui est par conséquent Néant.
 |
LA THEOLOGIE DES DEUX PRINCIPES :
|
Or les cathares ne peuvent concevoir
qu'un Etre unique ait pu créer à la fois le Royaume incorruptible où il n'y a
pas de place pour le Mal, et le Monde transitoire où le Mal se manifeste. Il
faut donc supposer deux principes créateurs distincts et opposés.
Cette croyance fondamentale du catharisme
fait appel à trois types d'arguments :
 |
un argument de pure logique formelle
emprunté à Aristote : « Les principes des contraires sont des contraires. Or le
Bien et le Mal sont des contraires. Ils ont donc des principes contraires ». Et
comme écho à cet argument, les cathares citent l'Evangile de Matthieu : « Tout
arbre qui est mauvais porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de
mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons ».
|
 |
un argument scripturaire, c'est à dire
tiré des Ecritures, en l'occurence le troisième verset de l'Evangile de Jean : «
Per ipsum omnia facta sunt, et sine ipso nihil factum est ». Les catholiques
traduisent : « Par lui (Dieu) tout a été fait, et sans Lui rien n'a été fait »,
pléonasme que les cathares récusent. Ils traduisent : « Sans Lui a été fait le
Néant ». C'est à dire, évidemment, le Monde visible. Interprétation qui a
suscité, de leur temps, bien des polémiques, pour savoir si le latin nihil,
adverbe de négation, pouvait aussi être un substantif. Non, disaient les
docteurs catholiques. Oui, disaient les cathares, qui en trouvaient maints
exemples dans le Nouveau Testament (dont la phrase de Paul qu'on a cité plus
haut).
|
 |
Mais ils butaient alors sur une
difficulté : Jean dit bien que Dieu a TOUT créé ; comment imaginer alors une
autre Création, qui a pu être faite SANS LUI (fût-ce celle de « Néant » ?). Les
cathares répondaient que TOUT n'a pas toujours le même sens dans le Nouveau
Testament quand Jean dit que Dieu a tout créé, il faut entendre par là la
totalité invisible, la Bonne Création (omnia invisibilia) ; mais il y a aussi une
totalité visible (omnia visibilia), que Dieu n'a pas créée. La preuve, c'est que
l'Ecriture dit aussi : « Tout est vanité ». Il ne peut donc s'agir du même «
Tout », car Dieu ne peut avoir créé une totalité vaine. Il y a donc une Mauvaise
Création, qui a son propre principe.
|
 |
le troisième argument est d'ordre
existentiel ; c'est le refus quasi-viscéral (et sur lequel aucun argument de
raison n'a de prise) de croire qu'un Dieu infiniment bon a pu créer les
conditions qui permettent au Mal de se manifester, c'est-à-dire la matière et le
temps, autrement dit le Monde. Pour les catholiques, Dieu étant tout-puissant,
le Mal peut faire partie de ses desseins secrets. Les cathares, eux, inversent
en quelque sorte la hiérarchie des attributs divins. Certes, Dieu est
tout-puissant, disent ils, mais dans le Bien seulement, car sa toute-puissance
est limitée par son infinie bonté. Puisqu'il est Amour, il ne peut permettre le
Mal, sans se contredire ou se renier.
|
Il faut donc supposer, distinct de Dieu,
un principe créateur du Monde où le Mal se manifeste. Mais distinct ne veut pas
dire égal. Ce principe est incréé et coéternel au Dieu bon. Mais il n'est pas un
« vrai Dieu ». On l'appelle certes parfois le « Dieu étranger », mais il ne
saurait être mis sur le même plan que l'autre. Il est le Prince de ce Monde, le
Prince des Ténèbres, l'Ennemi Malin. Mais il n'a pas l'existence absolue qu'a
seul le Vrai Dieu. Il est principe négateur, corrupteur, destructeur (non point
« créateur » au sens fort). Et sa « création » à lui doit être comprise comme la
tentative permanente de destruction de la Bonne Création : face à l'Esprit, il «
invente » la Matière (pour faire tomber l'Esprit en l'y attirant) ; face à
l'Eternité, il « invente » le Temps, pour que tout se corrompe dans la durée.
Bref, son but, c'est que le Royaume s'abîme et s'anéantisse dans le Monde. C'est
une puissance purement « néantisante », qui, opposée à Dieu, est en quelque
sorte son envers, mais non son égal, ni en valeur, ni en Etre.
C'est ainsi que les cathares rendaient
compte de l'expérience du Mal, et, surtout, de la « pesanteur » du Mal.
 |
LE MYTHE DE LA CHUTE :
|
Par son âme, l'homme participe du Royaume
de l'Esprit, de la Bonne Création ; par son corps, du Monde, de la Création
mauvaise. C'est, disent les cathares, « le monde du Mélange ». Et celui-ci s'est
constitué à la faveur de « la grande Perturbation », c'est-à-dire de la Chute,
qu'ils exposent au travers de plusieurs Mythes. Qu'on l'appelle Satan, Lucifer
ou le Diable, une émanation du Principe du Mal est venue tenter les Esprits,
dans le but de nuire au Dieu Bon. Les uns, séduits, ont consenti à le suivre,
d'autres sont tombés par mégarde. Le Malin leur fit alors des « tuniques de peau
» pour les y emprisonner, et c'est ainsi qu'il a jeté les âmes sur la « terre
d'oubli » où elles n'ont plus connaissance de leur origine ni de leur essence de
« réalités célestielles ». Chaque âme a cependant laissé auprès de Dieu son
double spirituel, auquel les cathares conservent le nom d'Esprit. On verra que
le salut s'opère par la réunion de l'âme et de l'esprit.
C'est essentiellement au sujet de la
Chute que certaines divergences se sont fait jour au sein des églises cathares ;
pour les unes, le Diable a agi à l'insu de Dieu : c'est le Dualisme absolu ;
pour d'autres, il a agi Dieu le sachant, voire avec son consentement ; c'est le
Dualisme « mitigé ». En regard de l'unité globale du système, la différence est
relativement secondaire, et cette opposition dogmatique a très bien pu ne
recouvrir, en fait, que des querelles de personnes. Il semble qu'une grande
majorité de cathares aient été dualistes absolus. Ce fut notamment le cas de
ceux du Languedoc.
 |
LA CONNAISSANCE SALVATRICE :
|
On conçoit aisément que le salut
consistera, pour l'âme, à se libérer de sa prison de chair, à quitter le Monde
pour revenir au Royaume. Mais la mort, pour les cathares, ne la libèrera pas
automatiquement du corps, pour un Jugement (auquel ils ne croient pas) qui
l'enverrait pour l'éternité, soit au Paradis, soit en Enfer : il n'y a pas
d'autre Enfer que le monde d'ici-bas. L'âme ne reprendra sa place auprès de Dieu
que si, s'arrachant à l'oubli, elle parvient à la connaissance de sa nature
divine, vérité suprême qu'une créature de Dieu, envoyée par Dieu, est venue
révéler aux hommes le Christ. Seul le baptême, institué par le Christ, permet
d'accéder à cette connaissance. Après quoi l'ascèse prépare la libération de
l'âme. Faute d'avoir reçu le baptême, ou à cause d'une préparation insuffisante,
l'homme verra son âme passer dans un autre corps. Saint Paul ne dit-il pas
lui-même qu'il est déjà mort une fois ?... Cette métempsychose s'étend aux
animaux : les cathares croyaient que le corps animal aussi est la prison d'un
esprit céleste déchu ; et l'âme humaine peut très bien se réincarner en lui.
La connaissance salvatrice est de
caractère initiatique : c'est une gnose ; elle ne peut venir que de l'Esprit
Saint. Les cathares disent dans leur Rituel qu'ils la tiennent sans interruption
des Apôtres, donc du Christ lui-même ; elle s'est transmise par imposition des
mains. Infusion de l'Esprit par ceux qui le possèdent déjà parce qu'ils l'ont
eux-mêmes reçu, il s'agit, pour les cathares, du seul baptême véritable ; c'est
un rite de transmission de connaissance par contact, en opposition au baptême
d'eau de saint Jean-Baptiste, qui est un rite de purification par immersion : il
« lave », mais il n'« apprend » rien. Jean-Baptiste lui-même a dit d'ailleurs : «
Un autre viendra après moi, plus fort que moi, et il vous baptisera par le feu
et l'Esprit ». Et, de fait, le Christ imposa les mains. Ce « baptême de feu »
(par opposition à l'eau), les cathares l'appelaient « baptême spirituel » . La
symbolique est claire : c'est sous forme de langues de feu que le Saint-Esprit
descendit sur les Apôtres. On l'appelle aussi Consolation, « consolament » en
occitan, « consolamentum » dans les textes latins, parce que c'est le Paraclet,
ou Saint-Esprit consolateur, qui infuse la gnose, « l'entendensa del be »,
l'entendement du Bien, équivalent occitan de la Connaissance du Souverain Bien
des Gnostiques. Ainsi s'opère un mariage spirituel, la réunion mystique de l'âme
emprisonnée dans le corps avec son Esprit resté au « Ciel » ; l'âme « reçoit »
son Esprit ; l'Esprit vient chercher son âme, ou du moins lui révéler le moyen de
se libérer pour le rejoindre.
Si le Mal triomphe dans le Temps, le Bien
seul peut triompher dans l'Eternité : toutes âmes se libèreront, et la totalité
de la (Bonne) Création sera sauvée.
 |
LE CHRIST MESSAGER :
|
On voit que le Christ des cathares est
bien différent de celui des catholiques. Sa mission ne fut pas rédemptrice. Dieu
l'a envoyé pour transmettre un message, pour révéler la Vérité, non pour racheter
par sa mort les péchés des hommes.
Sur sa nature exacte, les cathares font
preuve d'ailleurs de quelques incertitudes (voire de contradictions). Parfois
ils le disent Dieu, un avec le Père. Parfois ils le disent créature de Dieu,
Fils engendré ou adopté (en tout cas postérieur et inférieur au Père). Bref les
cathares, incontestablement, hésitent ou trébuchent sur le Mystère de la
Trinité.
De même sur celui de l'Incarnation. Le
Christ n'eut pour eux qu'une apparence humaine, un « corps fantastique », comme
le montrent maints passages des Evangiles où il a la consistance fantomatique
d'une apparition. N'étant pas réellement homme, il n'est pas réellement mort sur
la Croix. Les cathares respectent cependant sa Passion apparente, sorte
d'accident historique, victoire provisoire du Mal (dans le Temps seulement, pas
dans l'Eternité) et ils en font le récit dans leurs sermons. Mais ils se
gardent d'adorer la Croix, instrument du supplice : « Si on avait pendu ton
père, disent-ils, adorerais-tu la corde qui l'a fait mourir ? ».
Des miracles, ils ont une interprétation
purement spirituelle et symbolique, non point matérielle. Quand le Christ guérit
les aveugles en les touchant de sa salive, il faut comprendre que par sa parole
il leur rend la vue de l'esprit, non celle du corps, c'est-à-dire les ouvre à la
connaissance. De même pour la Cène : le pain et le vin qu'il distribue aux
disciples sont son corps et son sang dans un sens purement spirituel,
c'est-à-dire qu'ils sont son message, cette Parole avec laquelle effectivement,
il ne fait qu'un. Les cathares ne croient donc pas à la présence réelle dans
l'hostie, et rejettent l'eucharistie comme une puérile idolâtrie. Ce qui ne les
empêche pas de rompre eux-mêmes le pain en mémoire du Christ, mais à titre
d'hommage, non de communion, au sens catholique.
 |
« PARFAITS » ET « CROYANTS » :
|
Le « baptême spirituel » par imposition
des mains, le « consolament », est le seul sacrement des cathares. On ne peut le
donner qu'aux adultes, car la foi, le libre choix, le consentement conscient
clairement formulé, sont nécessaires : les cathares rejettent le baptême des
petits enfants, ignorants du sens du sacrement, comme une aberration.
On a vu la fonction du consolament dans
l'économie du Salut. Pour comprendre maintenant les circonstances dans
lesquelles il se donnait, il faut bien se représenter que, comme le
catholicisme, le catharisme a ses simples fidèles, et ses ministres.
On appelle les premiers les « croyants ».
Les « croyants des hérétiques », précisent les documents inquisitoriaux. Ce sont
les ministres, les membres du clergé cathare, et eux seuls, qui ont droit aux
noms de « chrétiens » , « bons chrétiens » , « bonshommes »` ou « Amis de Dieu
». Ce sont eux que les historiens ont pris l'habitude d'appeler « Parfaits », ou
« Parfaites » quand il s'agit de femmes. Le mot est commode, mais il faut quand
même remarquer, là encore, qu'ils ne se nommaient jamais ainsi. Ce sont les
inquisiteurs qui appelaient « hereticus perfectus » l'homme qui avait reçu le
consolament, c'est-à-dire « hérétique achevé » ou « accompli », sans mettre dans
le mot de « perfectus » la notion de « perfection » telle que nous l'entendons.
Le simple croyant ne recevait le
consolament qu'à l'article de la mort, pour « faire une bonne fin ». Tout au
long de sa vie, la fréquentation des Parfaits et l'enseignement qu'il
dispensaient par leur prédication, l'y préparaient. Il fallait, pour le
recevoir, qu'il ait encore l'usage de la parole, afin de répondre aux questions
de l'officiant et dire les prières. On ne « consolait » donc pas les comateux.
Mais lorsque la persécution ou la guerre faisaient encourir le risque d'une mort
violente et subite (par exemple pendant le siège de Montségur en 1244) les
croyants s'entendaient à l'avance avec les Parfaits ; ils faisaient leur « convenenza ».
A la fois baptême des mourants et
extrême-onction, le consolament est aussi sacrement d'ordination, lorsqu'un
croyant veut, par vocation, devenir Parfait, et recevoir le sacrement sans
attendre ses derniers jours. Il fait alors un noviciat de trois ans dans une
maison de Parfaits ; c'est à la fois une initiation spirituelle, un enseignement
dogmatique, et une préparation pratique à la règle de vie très contraignante à
laquelle il sera soumis après son ordination, ainsi qu'au ministère dont il sera
chargé : action pastorale d'assistance aux croyants et de prédication,
distribution du consolament, mais aussi travail manuel, tâches de la vie
communautaire, voire gestion d'une Maison.
Théoriquement, puisque le rituel est le
même, un simple croyant qui se fait « consoler » parce qu'il est gravement
malade et craint de mourir, mais qui vient à guérir, devrait ne pas retourner au
siècle, et vivre désormais en Parfait. Dans la pratique, les Parfaits qui
l'avaient « consolé » faisaient tout pour le convaincre de demeurer parmi eux,
mais, s'il n'avait pas la vocation, ils ne l'y contraignaient point. Le consolé
redevenu simple croyant recevait plus tard, sur son lit de mort, un nouveau
consolament. On connaît quelques cas de « consolés » qui, se voyant guérir, se
sont laissés mourir par inanition ; c'est « l'endura », qui signifie « jeûne »
en occitan. Mais ce suicide ne fut jamais rituel, il ne fut jamais imposé par
l'Eglise cathare, contrairement à ce qu'ont longtemps laissé penser les
accusations malveillantes de ses adversaires.
L'Inquisition, elle, ne faisait pas de
distinction entre le consolé et l'ordonné. Quiconque avait reçu le consolament
était, à ses yeux, « hereticus perfectus », et, à ce titre, périssait sur le
bûcher à moins qu'il n'ait abjuré.
 |
LA LITURGIE DU CONSOLAMENT :
|
L'officiant est nécessairement un
Parfait, puisqu'il faut avoir reçu le consolament pour pouvoir le donner. La
cérémonie d'ordination se déroule en présente d'autres Parfaits, ainsi que des
parents et des amis du, ou de la récipiendaire. Celui-ci ou celle-ci répond
d'abord aux questions de l'officiant, puis, après que tous les Parfaits présents
aient donné leur accord, il fait le voeu de suivre « la règle de justice et de
vérité », et « se donne à Dieu et à l'Eglise des Bons Chrétiens ». C'est alors,
s'il est marié, que son conjoint lui donne son consentement, en l'absolvant du
lien conjugal. Après un échange de phrases rituelles, le postulant peut recevoir
la « tradition » (c'est-à-dire la transmission) « du Livre et de l'Oraison
dominicale », c'est-à-dire du Nouveau Testament et de la Parole du Seigneur. Il
s'agenouille devant une table recouverte d'un linge. L'officiant place sur sa
tête le Nouveau Testament, et, de même que tous les Parfaits présents, pose
dessus sa main droite. Il récite alors le « Benedicite », puis trois « Adoremus
», sept « Pater », de nouveau trois « Adoremus ». Après lecture du début de
l'Evangile de Jean, il reprend trois « Adoremus » et conclut par la formule du
Pardon.
Lorsqu'il s'agit du consolament d'un
mourant, l'état du malade oblige parfois à abréger la cérémonie. Le malade
reçoit le sacrement sans quitter son lit. Pendant les périodes de persécution (ce fut le cas en Languedoc sous l'Inquisition, pendant un siècle, à partir de
1230) le consolament était donné clandestinement en présence de deux Parfaits
seulement, l'officiant et son « soci », c'est-à-dire son compagnon, amenés en
cachette, et en général de nuit, par des agents dévoués de l'Eglise interdite.
 |
LE TRAVAIL ET L'ASCESE :
|
La règle fait obligation au Parfait,
comme à la Parfaite, de travailler et de vivre de son labeur, en vertu du
précepte de saint Paul : « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange
pas non plus ». Qu'il soit d'origine noble ne change rien à cette obligation.
Les Parfaits exercent donc tous les métiers possibles : ils sont cordonniers,
chapeliers, peaussiers, tailleurs, bourreliers, charpentiers, colporteurs,
ouvriers agricoles saisonniers, etc. et, très souvent, tisserands, par référence
à saint Paul encore, qui était fabricant de tentes. On connaît aussi, en
Languedoc, des Parfaits médecins, suffisamment renommés pour que la noblesse
croyante se soit attaché leurs services. Les femmes sont fileuses, pratiquent le
tissage, et surtout la couture, fabriquant des vêtements féminins, voiles,
chemises, gants.
Parfaits et Parfaites doivent vivre et se
déplacer au minimum par deux. Ils sont vêtus de noir ou de bleu foncé, d'où
l'expression « prendre la vêture » pour désigner l'ordination. Le fil ou la
corde dont ils se seraient ceint la poitrine est une légende malveillante propre
à faire croire qu'à l'égal des sorciers ils usaient de pratiques magiques. Les
hommes portaient la barbe (du moins pendant les périodes) où ils pouvaient, en
toute liberté, se distinguer des laïcs.
Les observances étaient très nombreuses.
L'ascèse cathare rappelle les règles monacales les plus rigoureuses. Mais,
contrairement à ce qui se passe chez les catholiques, elle n'a pas seulement
valeur disciplinaire : se détacher du monde pour mieux se consacrer au service
de Dieu. Elle a valeur métaphysique et trouve sa raison dans le dualisme
lui-même.
Tout d'abord, l'interdiction absolue de
toute nourriture carnée ou d'origine animale : viande, graisse, oeufs, lait,
beurre, fromage. Les raisons en sont multiples. Le Christ a dit « Tu ne tueras
point ». On ne peut donc tuer les animaux. Il peut y avoir en chaque animal une
âme qui attend son salut : il ne faut pas intervenir dans son destin. Enfin,
toute chair provient d'un acte de génération, qui est par essence diabolique,
ainsi qu'on va le voir. Mais le poisson, animal réputé « à sang froid », était
autorisé, tout comme il l'est aux catholiques pendant le carême ou le vendredi.
Parfaits et Parfaites étaient astreints à
trois carêmes par an, l'un précédant les Rameaux, le second partant de
Pentecôte, le troisième précédant Noël. Toute l'année, ils jeûnaient au pain et
à l'eau les lundis, mercredis et vendredis. Cette sous-alimentation évidente
entraînait une pâleur émaciée qui a frappé leurs contemporains.
Autre règle absolue : la continence. Il
ne s'agit pas d'un célibat ou d'une chasteté simplement disciplinaires l'acte de
génération est une diabolique invention propre à retarder la libération des
âmes. C'est pour multiplier les " prisons de chair " que le Mauvais Principe a
créé la différenciation sexuelle et la concupiscence. L'union charnelle est donc
mauvaise par essence, et aucun sacrement ne peut la rendre licite. L'Eglise
catholique prétendant la consacrer par le mariage, les cathares l'accusaient de
se conduire en proxénète. L'observance était si stricte qu'un Parfait ou une
Parfaite n'avait pas le droit de toucher, et évitait même de frôler, une
personne du sexe opposé.
 |
LA REGLE DE JUSTICE ET DE VERITE :
|
Le consolament faisant accéder l'ordonné
à l'état « de justice et de vérité », il est de règle absolue de suivre à la
lettre les préceptes évangéliques, lesquels ne souffrent aucune exception.
Le serment est rigoureusement prohibé («
Je vous dis de ne pas jurer du tout » - Matthieu, 5, 34). Il en est de même du
mensonge volontaire, même pour un Parfait tombé entre les mains de
l'Inquisition, et interrogé. Certains réussissaient cependant à éviter des aveux
trop explicites grâce à des circonlocutions obscures et à des restrictions
mentales. La prohibition du meurtre n'est pas moins absolue (« Tu ne tueras
point »), même en cas de légitime défense. Elle s'étend évidemment à tous les
animaux, sauf aux poissons et aux crustacés. Le refus de saigner des poulets
devant les Inquisiteurs a conduit maintes Parfaites au bûcher.
Les cathares refusaient la justice
séculière (« Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ... »). Joint à la
prohibition du meurtre, ce précepte faisait d'eux des apologistes de la non violence, et des adversaires de la peine de mort. Le croyant coupable de
crime était tenu, en guise de pénitence, de se faire ordonner Parfait. Ce fut le
cas de Bélibaste, le dernier Parfait occitan connu, brûlé par l'Inquisition en
1321. Lorsqu'un conflit surgissait entre des croyants, ceux-ci, plutôt que
d'aller devant la justice civile, en appelaient à un Parfait qui arbitrait et
réglait les choses à l'amiable.
A noter enfin que les cathares
considéraient la lâcheté comme un péché très grave, et mettaient le courage
devant la souffrance et la mort au-dessus de toutes les vertus. L'ordonné
s'engageait d'ailleurs à ne pas les craindre, et à ne pas avoir peur, en
particulier, du supplice par le feu.
Tout manquement à la règle était très
grave, puisque, libéré du Mal par l'infusion de l'Esprit, le Parfait était
pleinement responsable. S'il péchait, il ne pouvait obtenir son pardon qu'au
terme d'une longue et dure pénitence, et un nouveau consolament était
nécessaire.
Le simple croyant, lui, étant sous
l'emprise du Mal, n'est pas totalement libre de ne pas pécher. En quelque sorte,
c'est le Diable qui pèche en lui. Il n'est pas soumis à la règle de vie des
Parfaits. Il peut avoir une femme, des enfants ; il peut manger de la viande,
faire la guerre, etc. Mais il doit bien entendu avoir la foi, croire ce que
prêchent les Parfaits, aspirer à la vertu, se préparer au consolament qu'il
recevra sur son lit de mort. L'Eglise cathare veille sur lui, l'incite et l'aide
à une purification qui éveillera peut-être en lui la vocation de devenir Parfait
à son tour. Le croyant a par ailleurs maints devoirs envers l'Eglise des
Parfaits. Quand il rencontre des Parfaits ou des Parfaites, il doit accomplir le
rite de « l'amélioration », « melhorer » en occitan, « melhoramentum » en latin,
devenu « adoratio » dans les textes inquisitoriaux trois génuflexions
accompagnées chacune d'un Benedicité, à quoi l'un des Parfaits répond : « Que Dieu
vous bénisse, fasse de vous un bon chrétien et vous conduise à une bonne fin ».
Le croyant doit aller écouter la
prédication, assister aux cérémonies de l'Eglise, qui sont toutes publiques, et
s'achèvent par le Baiser de Paix rituel échangé par les Parfaits (avec les
Parfaites quand il s'agit de croyantes). Souvent enfin, il partage le repas des
Parfaits et le Pain de la Sainte Oraison, béni et rompu par le ministre qui
préside, en souvenir, on l'a vu plus haut, de la dernière Cène du Christ.
 |
L'EGLISE ET LA SOCIETE CATHARES :
|
L'Eglise cathare est organisée. A-t-elle
eu un chef suprême coiffant à la fois les diocèses cathares d'Occident et les
églises bogomiles des Balkans ? Diverses sources font bien allusion à un « pape
des hérétiques » , et Nicétas, en 1167, pourrait effectivement avoir eu ce rôle.
Mais beaucoup trop d'indécisions et d'imprécisions planent encore sur ce point
pour que l'on puisse trancher, du moins en l'état actuel des connaissances.
Ce qu'on sait par contre de façon
certaine, c'est que l'Eglise était divisée en évêchés. Les quatre diocèses
occitans furent créés précisément en 1167 : Agenais, Toulousain, Albigeois et Carcassès, ainsi qu'un diocèse « de France ». Un cinquième diocèse occitan fut
créé en 1226, celui du Razès. Pour l'Italie, on connaît les diocèses de
Desenzano, Concorezzo, Bagnolo, Vicence, Florence, Val de Spolète. Pour les
Balkans, ceux de Bulgarie, Dragovitie, Mélinguie, Dalmatie. Chaque évêque était
assisté de deux coadjuteurs, un Fils Majeur et un Fils Mineur. A la mort d'un
évêque, chaque coadjuteur montait d'un grade, et l'on élisait un nouveau Fils
Mineur. Venaient ensuite les diacres, responsables d'une portion plus ou moins
étendue du diocèse. Evêques, Fils et diacres, on connaît quatre-vingts
dignitaires cathares ayant exercé leur ministère dans le seul Languedoc durant
le XIII° siècle.
A la base de cette organisation, les
communautés de Parfaits et de Parfaites (évidemment séparées) les « Maisons »,
dirigées par l'Ancien ou la Prieure. Ce sont à la fois des ateliers d'artisanat
et des séminaires, où l'on dispense aux novices une formation professionnelle en
même temps que l'enseignement dogmatique et moral qui va faire d'eux, s'ils s'en
montrent dignes, des Parfaits et des Parfaites.
Ces derniers, outre l'obligation du
travail manuel, doivent consacrer une grande partie de leur temps à la prière,
et, les hommes surtout, à la prédication, au cours de laquelle ils commentent le
Nouveau Testament devant les croyants (principalement l'Evangile de Jean et
l'Apocalypse). Plus d'un millier de Parfaits et de Parfaites occitans sont connus
pour la période qui va de 1200 à 1250. Beaucoup de Parfaits vont de maison en
maison pour s'adonner à la prédication itinérante, laquelle peut avoir lieu
n'importe où : Maison des Parfaits, mais aussi demeures particulières, places
publiques, champs ou vergers. Et dans les bois, dans les greniers, dans mille
autres cachettes pendant la période de clandestinité.
Chaque mois, la communauté pratique le
rite du « Service », « Apparelhament » en occitan. Parfaits et Parfaites font
acte de soumission et se confessent au diacre venu les visiter. Les croyants
peuvent y assister. Un prêche suit la cérémonie, qui se termine par le Baiser de
Paix.
Parfaits et Parfaites, on le voit, sont
tout le contraire de reclus ou de contemplatifs : leur Eglise est en contact
permanent avec la masse des fidèles. Par le biais des Maisons-ateliers, elle est
totalement intégrée à la vie sociale et économique. Elle est certes une
institution, mais pas au sens où l'Eglise romaine en est une aussi.
Contrairement à cette dernière, l'Eglise cathare ne participe pas de la
hiérarchie féodale, elle n'a ni vastes biens fonciers ni pouvoir temporel, elle
n'exerce sur les couches travailleuses aucune tutelle d'ordre fiscal ou social,
ne perçoit pas de dîmes et ne fait pas travailler de serfs. Ce qui doit
d'ailleurs expliquer en grande partie son succès. Mais si Parfaits et Parfaites
vivent très modestement, leur Eglise est riche ; elle constitue des trésors
monétaires grâce au produit du travail manuel, et des dons en espèces que les
croyants ont coutume de faire lorsqu'ils reçoivent le consolament à l'article de
la mort. Cet argent, l'Eglise l'utilise au développement des Maisons, elle le
remet en circulation en le prêtant à intérêt ; pendant la persécution
languedocienne, elle l'envoie aux émigrés de Lombardie, ou elle l'utilise pour
acheter des complicités dans le pays, et payer les escortes armées qui
accompagnent les Parfaits allant clandestinement donner un consolament.
L'Eglise gérait parfois les fonds des
croyants : c'est ainsi qu'il y avait une véritable banque (ou une caisse
d'épargne) à Montségur, à l'époque du célèbre siège.
 |
L'IMPLANTATION DU CATHARISME :
|
Qu'on l'appelle bogomilisme, patarinisme
ou catharisme, la religion dualiste attestée du XI au XV° siècle avait vocation
d'universalité. Elle fut un fait européen.
Le pays où elle est le plus anciennement
attesté est la Bulgarie, où un « pope » nommé Bogomil la prêchait vers l'an 950.
Etait-ce son nom réel, l'équivalent bulgare du grec « Théophile » ? Ou bien un
surnom, en tant que chef de l'Eglise des Amis de Dieu ? On n'en sait trop rien.
De Bulgarie, en tout cas, le bogomilisme gagna la Dragovitie (Macédoine
occidentale), la Mélinguie (Péloponnèse) ; à l'est, Philadelphie, dans la
Turquie actuelle ; à l'ouest, la Dalmatie et la Bosnie. A la fin du XII° siècle,
le « ban » de Bosnie, Kulin, le proclama même religion d'Etat. La croisade
conduite par le roi de Hongrie sur ordre de la Papauté ne l'empêcha pas de s'y
maintenir. Le bogomilisme ne disparut des Balkans qu'avec la conquête turque,
commencée en 1463, achevée en 1481.
Que le bogomilisme ait irradié à partir
des Balkans grâce à des prédicateurs itinérants qui empruntaient les grandes
voies commerciales (vallées du Pô, du Rhône, du Rhin) ne veut pas dire qu'il
n'y ait pas eu aussi, en Occident, des foyers spontanés de dualisme. Une
première vague « hérétique » est attestée dans le premier tiers du XII° siècle :
Vertus en Champagne vers l'an 1000, Toulouse en 1017, Orléans en 1022, Monteforte en Italie en 1034. De 1050 à 1100, on constate un recul très
sensible, qui coïncide avec les succès de la réforme grégorienne. Mais tout
repart de plus belle à partir de 1100, et l'on a pu dire que le XII° siècle
avait été « l'âge d'or de l'hérésie » : Anvers, Louvain et Bruges de 1110 à
1115, Soissons en 1114, Utrecht en 1135, Liège en 1135 et 1144, Toulouse et
l'Albigeois en 1145, Oxford en 1160, Cologne et Besançon en 1163, Trêves en
1164, Vézelay en 1167, Arras en 1172, Reims en 1180, Troyes en 1200, Londres en
1210, Strasbourg en 1211, etc. Entre temps, on l'a vu, le catharisme s'était
organisé en évêchés dans le comté de Toulouse et la vicomté de Carcassonne, et
s'était solidement implanté en Lombardie et en Italie centrale. Plus tard,
franchissant les Pyrénées, il gagnera la Catalogne et le nord de l'Aragon.
|
 |
LA REPRESSION : CROISADE ET INQUISITION
:
|
Très vite, l'Eglise romaine alerta les
pouvoirs temporels pour faire obstacle à la montée d'une religion qui, à la
fois, s'opposait au dogme officiel, et menaçait cette même Eglise jusque dans
ses structures et ses institutions : les cathares, évidemment, ne payaient pas
la dîme à une Eglise dont ils disaient qu'elle était l'Eglise du Diable,
puisque, adorant le Dieu de la Genèse, elle adorait le créateur du Monde
visible.
Là où les pouvoirs jouèrent le jeu de
Rome, la répression fut terrible : les dates citées plus haut sont, pour la
plupart, celles de pendaisons ou de bûchers. Mais là où la féodalité et les
consulats urbains refusèrent de s'associer à la répression, le catharisme put se
développer quasi librement, et s'institutionnaliser à son tour. Ce fut le cas,
outre la Bosnie, des villes lombardes et du Languedoc. Là, on n'a plus à faire à
des « sectes » livrées au supplice aussitôt qu'apparues et repérées, mais à une
véritable « contre-Eglise » qui s'oppose ouvertement à Rome, qui s'organise, et
qui a ses propres structures économiques et sociales. Bref, un monde nouveau qui
menace de se substituer à l'ordre établi.
La répression du catharisme languedocien
fut une immense tragédie : l'ampleur de l'entreprise eut même des conséquences
politiques qui en firent une grande page de l'histoire du pays d'Oc et de la
France, puisqu'elle livra à la Couronne capétienne tout le Languedoc, alors
beaucoup plus naturellement attiré par Barcelone que par Paris. Appelée de ses
voeux par le pape Innocent III dès 1198, la « Croisade contre les Albigeois » se
mit en marche en 1209. Neuf ans durant, les barons du Nord conduits par Simon de
Montfort mirent le pays à feu et à sang, jetant Parfaits et Parfaites au bûcher,
mais aussi massacrant les populations sans distinction de religion, et
confisquant à leur profit les domaines conquis. Un prince catholique intervint
contre eux : Pierre II, roi d'Aragon, comte de Barcelone. Il trouva la mort en
1213 à la bataille de Muret, et Simon de Montfort fut proclamé par Rome comte de
Toulouse.
De 1216 à 1224, les seigneurs occitans
conduisirent une guerre de libération qui leur permit de récupérer tous leurs
domaines ; et le catharisme retrouva ses positions d'antan. Mais la croisade du
roi Louis VIII, en 1226, amorça l'irrémédiable défaite des princes occitans,
consacrée en 1229 par le Traité de Paris sanctionnant la conquête et l'annexion.
L'Inquisition prit alors le relais de la chevalerie du Nord dans la chasse aux
Parfaits et aux Parfaites. Il lui fallut un siècle pour les traquer, les
capturer, les brûler un par un, démanteler leur Eglise, extirper des têtes et
des coeurs la religion des Deux Principes. Mais l'action de la catholicité fut
aussi spirituelle. Créés pour les besoins de la cause, les ordres mendiants,
Dominicains et Franciscains, en proposant aux hommes de foi un mode de vie
apostolique qu'ils ne trouvaient auparavant que dans le catharisme, leur donna
la possibilité de " faire une bonne fin " sans quitter l'Eglise romaine. En
Italie aussi, le catharisme finit par s'éteindre au XIV° siècle, sous les effets
combinés de la violence inquisitoriale, et de l'attrait qu'exerçaient les
couvents des nouveaux moines.
Il reste que l'Occident avait reçu, avec
la foi et la morale prêchées par l'Eglise des Amis de Dieu, un message d'une
très grande profondeur. Il était très dur, très exigeant. L'Histoire l'a maintes
fois jugé trop pessimiste pour avoir eu de véritables chances de survie. Mais
c'était un immense message d'amour, et, sur bien des points, de tolérance et de
liberté. Ce n'est pas un hasard si le monde d'aujourd'hui se penche avec tant
d'émotion sur les cendres de cette religion martyrisée.
Texte complet et photos de l'ouvrage :
"La religion
cathare", de
Michel Roquebert (Editions Loubatières / Editions Milan-Presse)
Pour
agrandir, il suffit de cliquer sur les photos :)
|
